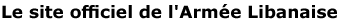- En
- Fr
- عربي
La Strategie: un Art ou une Science?
L’amateur de lecture a souvent du mal à se faire une idée nette et précise en ce qui concerne un certain nombre de concepts qui pourtant sont largement utilisés dans les médias et la littérature de masse en général. Au titre de ces concepts aux contours nébuleux nous pouvons citer celui de stratégie. Il. n’est, en effet, qu’à consulter deux ou trois dictionnaires de langue pour se rendre compte combien les définitions qui en sont proposées sont imprécises et, par conséquent, déroutantes.
Après un retour à l’étymologie du terme (ou stratos signifie, en grec, armée; et agein, dans la même langue, conduire) les différentes sources s’accordent pour souligner que la stratégie est le contraire de la tactique, ou que ces deux concepts se situent sur deux berges opposées, ou bien encore que la stratégique est opposé ou politique et à l’économique. Ce qui, bien entendu, ne concorde absolument pas avec la signification réelle et objective du concept statégie.
Il importe de signaler ici qu’une des raisons princopales de ce phénomène découle de l’histoire de la stratégie elle-même, qui a connu un grand nombre de conceptions différentes à travers les âges, et d’acceptions revêtant dans chaque aire géo-politique une signification différente. Car la stratégie, en tant qu’art militaire de la guerre, a varié selon les peuples, relativement à leur conception du Soi, du Nous et de l’Autre, comme le disent si bien les sociologues de la connaissance. Si bien qu’il n’y a jamais eu, au niveau de la vie pratique, d’application uniforme et unifiée de la stratégie pour que ce dernier concept puisse donner naissance, dans la tête des théoriciens, à un concept unique.
Ce qui a également joué en défaveur d’une définition unique de la stratégie est le fait que depuis le début du vingtième siècle ce terme n’est plus l’apanage du seul domaine militaire, puisqu’il est souvent question - et a juste titre d’ailleurs - de stratégie politique, économique ou même encore médiatique de telle ou telle puissance.
Pourtant, tout cela n’aura qu’un seul résultat: celui de nous prouves la vitalité de ce concept, de même que son importance de plus en plus grande dans la vie des sociétés contemporaines. La stratégie ne se situe plus sur les seuls champs de bataille, aujourd’hui, mais à tous les niveaux de notre vie citoyenne. Elle s’est déplacée de domaine militaire pur, pour s’introduire dans ceux de notre vie pratique quotidienne, car son en jeu n’est plus militaire, mais de plus en plus politique, économique et culturel.
Où se situe le tournant principal du concept de stratégie? Il nous semble que soit avec l’avènement des guerres napoléoniennes que le changement interne ait été opéré sur ce concept d’origine militaire, aujourd’hui largement globalisé. Mais avant de développer le processus suivi par le terme stratégie au cours des âges, revenons un moment sur celui de tactique - qui s’est beaucoup mieux conservé dans son acception militaire soit dit en passant.
Le général et théoricien prussien Carl Von Clavsewitz discerne la nuance suivante: “La tactique, dit-il, est l’emploi des forces armées dans le combat; la stratégie est l’emploi du combat en vue de la fin ultime de la guerre”.(1)
Cette mise au point de la part d’un praticien de la guerre est fort utile, puisqu’elle nous permet de mettre un terme à la fausse dualité dans laquelle est généralement placée la relation entre la tactique et la stratégie. Les deux piliers de la science de la guerre et des combats se complètent donc, et il est rare, après les guerres napoléoniennes, de rencontres de guerre tactique, sans stratégie, ou de guerre stratégique, sans tactique, ces deux éléments étant devenus inséparables et la stratégie ayant débordé le plan militaire pour rejoindre celui de l’économie et celui de la politique, voire même celui de la culture et de l’information.
Comment en est-on arrivé là? Comment la distance a-t-elle pu s’estomper entre la tactique et la stratégie d’une part, et comment la stratégie a-t-elle acquis ce caractère de globalité qui la caractérise aujourd’hui? Un retour aux expériences du passé s’avère ici nécessaire, en vue de faire la part des choses et de saisir l’évolution de ce concept-clé de la vie des sociétés modernes, pourtant âgé de plusieurs milliers d’années.
I - La Stratégie dans le Monde Ancien
Dans le Monde Ancien, la stratégie a rarement dépassé le cadre des commandants d’armée, appelés stratéges. C’etait un art au service de dirigeants militaires ayant en charge la responsabilité d’armées imposantes. Cet art, fort personnalisé, visait à la satisfaction des aspirations géo-militaires du commandant-stratège. La stratégie avait alors pour but essentiel la conquête de territoires se situant en dehors et loin des frontières du peuple inpliqué par son dirigeant dans la guerre. C’est le cas des Grecs avec Alexandre le Grand, des Carthaginois avec Hannibal, des Romains avec Jules César et des Tatares avec Genkis Khan, pour ne citer que les cas les plus connus.
Nous reviendrons tout de suite sur ces cas, mais, avant de pousser plus loin notre analyse, il importe de signaler que dans le Monde Ancien nombreux sont les peuples, en Asie et en Afrique notamment, qui n’ont pas produit de stratèges, se contentant de vivre au rythme des nécessités de leur auto-suffisance biologique. Au titre de ces peuples nous pouvons citer, à titre d’exemple, les Arabes de la Période Pré-Islamique (La Jihiliyya).
Ainsi, le chroniqueur arabe Aboul Fadl AL-MAYDANI (... - 1124) nous découvre dans son ouvrage Ayyâm al-’Arab fil Jahiliyya un aspect inédit de la vie des peuplades arabes de la Presqu’île Arabique. Leurs conflits militaires opposaient essentiellement des clans et des tribus, et était totalement dépourvus de stratégie. Il s’agissait tout au plus de tactiques de combat entre cavaliers plus ou moins nombreux.
Les Arabes donnaient à ces conflits le nom de ayyâm, qui signifie journées, vu que dans l’optique des gens de l’époque on nommait une guerre par le jour où elle se terminait. Certaines duraient plusieurs jours ou plusieurs semaines, d’autres plusieurs mois ou plusieurs années. Mais on les nommait toutes, invariablement, des ayyâm, des journées.
Or cette terminologie est significative, car la guerre était conçue dans l’espace. Le temps n’y représentait aucune valeur spécifique, perçu dans sa dimension infinie et plate.
C’est ainsi que AL-MAYDANI nous rapporte le nom de 131 guerres, inter-arabes dans leur totalité, ayant eu lieu durant la Jahiliyya. Il est à la fois curieux et intéressant de noter que ces guerres ponctuelles et inter-claniques, menées sous le signe de la tactique, étaient totalement dépourvues de relever les faits suivants:
34% désignaient une colline, une vallée, une plaine festile ou des espaces verdoyants.
31% désignaient des points d’eau.
20% désignaient le nom de la tribu victorieuse.
3% désignaient une ville ou un village.
3% désignaient des chevaux ou des chameaux.
3% désignaient des noms propres.
3% désignaient des emplacements sur la route rattachant La Mecque à Médine.
2% désignaient des qualités.
1% désignait le désert.
Le foyer principal des guerres de cette période se situe donc au niveau des pâturages et des points d’eau. L’instinct de suivre accapare l’essentiel de la pensée militaire. C’est pourquoi donc l’espace prime et le temps est absent. Dans la course à la survie de la tribu, seuls entrent en jeu les facteurs matériels de l’existence. Et ses supports immédiats (les points d’eau, les collines, les vallées, les espaces verdoyants) accaparrent la dynamique de la guerre dans sa globalité.
Ce type de guerre sans idée, et par conséquent sans stratégie, se situe aux antipodes d’un autre expérience vécue par ce même Monde Ancien, par des hommes tel qu’Alexandre le Grand (356 - 323 avant J.-C.), dont le nom est profondément incrusté dans l’histoire pour l’expérience typique qu’il a engendrée.
Désireux d’étendre sa zone d’influence géo-militaire, le jeune roi de Macédoine part en guerre contre l’empire achéménide de Perse à partir de l’année 334. Il s’est assuré la loyauté des généraux grecs demeurés dans le pays avant de partir en direction des lointaines contrées de l’Est.
A la bataille de Issos (novembre 333), les Grecs battent l’armée perse dirigée par Darius en personne et cinquante fois plus nombreuse que l’armée grecque. Par une attaque oblique, à la macédonienne de l’infanterie grecque, combinée avec une attaque sur le flanc gauche par la cavalerie dirigée par Alexandre en personne, la bataille est emportée et l’armée perse décimée.
A fin d’assurer ses arrières, Alexandre entreprend ensuite de contrôler la côte méditerranéenne (Byblos, Beyrouth, Sidon, Tyr et Gaza) pour livres bataille de nouveau à Gaugamèles à Darius III qui avait rassemblé un armée redoutable de 300.000 hommes environ. Après une nouvelle victoire, Alexandre se trouve en possenssion de l’empire perse.
Quelques temps après, à la tête d’une troupe de 40.000 hommes, il se dirige vers les montagnes de l’Afghanistan avant de pénétrer en Inde où il vaincra le roi Parus sur les berges du fleuve Hydaspe.
C’est là que ses hommes (dont il ne reste plus que 25.000 hommes) refusent de poursuivre la conquête de l’Asie. Le chef grec n’a plus alors qu’un seul choix: il retourne à Babylone où, quelques temps après, il meurt.
Son art de conduire les batailles militaires fut très personnel. La bravoure y jouait un rôle aussi important que la logique (il ne faut pas oublier qu’Alexandre fut l’élève d’Aristole). Mais il demeure, en définitive, que sa conception de la stratégie sera dépourvue de profondeur politique. Il s’agissait d’élargir les frontières de l’empire grec par la force militaire, à partir d’un rêve plutôt qu’à partir d’un projet aux contours bien définis. Si bien que lorsque les soldats grecs furent lassés de ces combats (pourtant victorieux) sans fin, ils coupèrent l’herbe sous le pied de leur chef et le contraignirent à retourner à Baby lone.
Il en fut de même pour Hannibal (247 - 183 avant J.-C.) qui, malgré ses qualités de stratège militaire, n’avait à proposer à ses hommes et alliés qu’un projet géo-militaire où la politique avait peu de place.
Le génie du chef carthaginois fut de portes la guerre contre les Romains sur le continent européen. A partir de l’Espagne puis de la Gaule, Hannibal se rapprochait dangereusement ainsi de la capitale de ses ennemis, préférant les batailles terrestres aux combats maritimes. Après avoir franchi avec difficulté les Pyrénées mais surtout les Alpes, son armée aboutit en Italie où il évitera de fondre sur Rome, laissant ainsi à ses ennemis de longues années pour contre-attaquer.
Sur le plan de la stratégie militaire, Hannibal fera preuve de qualités de géographe à chaque bataille, ne livrant combat contre son ennemi qu’après l’avoir obligé à s’engager dans un vallon ou bien après avoir coupé ses arrières, Les manoeuvres des troupes du commandant carthaginois mettent constamment à profit le relief du terrain et contournent l’ennemi avant de fondre sur lui. C’est ce qui s’est passé en Espagne, en Gaule, mais surtout lors de la bataille du 2 août 216, sur les bords de l’Ofento, en Italie, où 20.000 carthaginois vinrent à bout de 65.000 romains.
Jules César (101 - 44 avant J.-C.) par contre se distingue relativement de cette vision de l’art militaire, typique des temps anciens. La stratégie verra avec lui un début de politisation. Cette dernière démarche se fera toutefois dans le profit personnel du stratège Jules César et non dans celui de l’empire qu’il représente. Car après avoir vaincu les Gaulois et les Germains (entre 58 et 52), notamment à la bataille d’Alésia où il fait prisonnier Vercingétorix, le chef des Gaulois, le voilà qui se retrouve, avec son armée, contre l’empire romain lui-même, en l’année 50. A cette date-là, il franchit le Rubicon pour livres combat à un autre chef d’armée romain, Pompée, en vue de devenir empereur lui-même.
Après avoir mis à profit l’organisation et la discipline de fer dans son armée et largement compté sur la division de ses ennemis ainsi que sur l’effet de surprise dans ses combats contre les Gaulois et les Germains, voilà Jules César qui applique les mêmes tactiques contre ses propres frères d’armes, dans le cadre de ce que nous pouvons nommer sans hésitation une guerre civile. C’est d’ailleurs le titre que Jules César donne à un de ses écrits les plus connus.
La fin ultime de la guerre et son but se confondaient avec le projet personnel de Jules César dont la stratégie militaire n’avait d’autre dessein que servir de tremplin à ses aspirations politiques propres. Si bien que nous pouvons dire que la conception traditionnelle et ancienne de la stratégie n’a nullement évolué. Elle est demeurée dans le giron des capacités militaires d’un chef hors du commun, poursuivant un projet aux dimensions limitées, impliquant son propre pouvoir et cherchant à instituer ou a asseoir sa propre dynastie.
La stratégie était ainsi comprise, essentiellement, dans sa dimension géo-militaire. Le politique n’y tenait de place que dans la mesure où il assurait un bénéfice direct au stratège lui-même. C’est pour cette raison donc que la stratégie du Monde Ancien n’a jamais pu s’élever jusqu’au niveau d’une science, préférant demeurer un art manié avec dextérité par un génie.
II - La stratégie à l’époque médiévale en Europe
La guerre de Cent Ans qui a, en fait, duré cent seize ans (1337 - 1453), est une guerre interne européenne, issue du conflit opposant les représentants de la double monarchie franco-anglaise.
Le conflit dynastique entre les deux Couronnes, doublé d’une dimension féodale, remonte au mariage d’Henri Plantagenêt avec Aliénor d’Aquitaine, répudiée par le roi de France Louis VII en 1152. Or, en 1153, Henri Plantagenêt devient roi d’Angleterre; ce qui signifiait qu’il était désormais - dans le cadre géo-militaire de l’époque - plus puissant que le roi de france. Cela ne l’empêchait pas d’en demeurer le vassal pour un certain nombre de fiefs (la Normandie, le Maine, l’Anjou, L’Aunis et surtout la prospère Guyenne). Ce qui était fort incommodant et allait servir de base au long conflit, de type féodal, entre les deux pays, car la guerre allait bientôt traverser les lignages féodaux et dynastiques communs aux deux pays.
Il s’agira donc là d’une guerre à stratégie féodale, basée sur les sièges de places-fortes et surtout sur les chevauchées. Une guerre qui sera chèrement payée par la paysannerie française. La noblesse déclarait la guerre (la “guerre du roi” comme on le disait si bien à l’époque) et le peuple n’avait d’autre choix que de la suivre. La vision du monde prévalant à l’époque ne permettait pas une remise en question de ce principe et l’´glise lui offrait même sa bénédiction par son concept de “la guerre juste”.(2)
Il était hors de question que le peuple participe, en tant que personne politique ou morale indépendante à la guerre juste dont seuls les souverains avaient le privilège.
Par contre, le peuple ployait sous les devoirs, puisqu’il devait la financer et lui servir de main-d’œuvre gratuite. D’ailleurs, le célèbre mot d’ordre lancé par Charles V, roi de France, en 1359, et repris par toute la noblesse (“Mieux vaut pays pillé que terre perdue” révèle à quel point le cynisme politique de la noblesse était grand.
Les armées anglaises entreprenaient alors des :chevauchées” à travers le pays, ravageant tout sur leur chemin. Au cours de ces chevauchées, les cavaliers anglais, répartis en plusieurs colonnes, sur une largeur de cinq à six kilomètres, vivaient sur le pays et saccageaient tout sur leur passage. Le butin de ces chevauchées, énorme pour l’envahisseur, était désastreux pour les paysans français.
C’est ce qui explique d’ailleurs les nombreuses “jacqueries”, ou révoltes de paysans, qui accompagnèrent la guerre de Cent Ans, ainsi que le phénomène de Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orléans, jeune pausanne venue prendre la défense de son roi, mais délaissée par la suite par ce dernier et livrée par lui aux Anglais.
A la stratégie offensive du roi d’Angleterre, qui avait porté la guerre en territoire français dès le début des hostilitées, correspondait une stratégie défensive, menée par une noblesse française égoïste et souciense de ses seuls intérêts. Mais que ce soit dans le cas anglais ou dans le cas français la stratégie n’avait d’autre horizon que dynastique. Elle impliquait les seuls intérêts du souverain et de sa cour. Ce qui nous pousse à dire qu’il s’agissait d’une conception de la stratégie fermée, n’ayant pas d’autre dimension que celle de l’élite qui la menait.
Il est utile de notes ici que ce caractère fermé de la stratégie militaire des deux principaux belligérants de la Guerre de Cent Ans a ouvert la voie si l’on peut dire aux conflits internes de la noblesse. Si bien qu’au sein de la Guerre de Cent Ans nous pouvons dénombrer de petites guerres entre le roi de France et le duc de Bourgogne ou de Bretagne, ou bien entre tel duc et tel comte, ou bien encore entre deux comtes aux puissantes mini-armées.
C’est d’ailleurs un fait que le philosophe allemand Hegel n’a pas manqué de notes au terme d’une autre longue guerre, celle de Trente Ans (1618 - 1648) dont le chap de bataille se situa en Allemagne. Pour lui, on ne peut éviter la stratégie forcément fermée de la guerre que par la guerre dite nationale, c’est à dire en portant le conflit en dehors des frontières de la nation.
Si la guerre de Cent Ans se présenta comme la guerre du roi, la guerre de Trente Ans se présenta par contre comme la guerre de la foi. Les deux camps allemands qui se prêtaient à la guerre se définissaient par leur identité confessionnelle et religieuse. Dans le premier on retrouvait les catholiques, souvenus par l’Espagne et l’Italie, tandis que dans l’autre on retrouvait les protestants, soutenus par la Suède et la France.
Commentant le déchirement caisé par la Guerre de Trente Ans et surtout par les traités de Westphalie qui ont faussement mis fin, Hegel écrit: “En achevant la destruction de l’Etat, la religion, de façon admirable, a donné en contre partie le pressentiment de quelques principes qui peuvent être à la base d’un état. Ce qu’il faut aux hommes, puisque la division religieuse les a déchirés dans ce qu’ils ont de plus intérieur et que pourtant un lieu doit subsister, c’est une cohésion extérieure, fondée sur des choses extérieures, faire la guerre, car la cohésion est le principe des Etats modernes”.(3)
Il ne sert donc à rien de faire la guerre, selon le philosophe allemand, si sa stratégie générale est interne. Il faut en ouvrir la stratégie vers l’extérieur, vers un ennemi national, afin que le projet de guerre sur lequel elle repose puisse être bénéfique à l’Etat, donc à l’ensemble des citoyens.
Cet aspect de la stratégie, qui se doit de quitter le giron des stratèges en tant que personnes, pour rejoindre celui de l’Etat, est celui qui caractérisera sa modernité. Car, comme le montreront si bien les guerres de la Révolution française, la stratégie des commandants militaires sera désormais de caractère militaire et politique, voire même idéologique dans ce sens qu’elle devra forcément concerner tous les citoyens de l’Etat et non plus sa seule élite gouvernante.
III - La stratégie de la “guerre du peuple”,
après 1789
La conception de la stratégie des guerres modernes, introduite par les guerres napoléoniennes, est intimement liée au tournant pris par l’histoire politique depuis la Révolution française. Car, avec l’avènement de la Révolution de 1789, le concept de peuple a fait son irruption dans le champ politique que nous qualifions aujourd’hui de moderne. Aux stratégies fermées, reposant sur des armées de métier restreintes, qui étaient adoptées par les souverains en conflit de lar le monde jusque là, voilà qu’une stratégie ouverte et populaire faisait place.
La bataille de Valmy (20 septembre 1792) donne le ton de ce que seront désormais les conflits armés. Le général prussien Bronswick, dont les troupes sont supérieures en nombre par rapport aux troupes françaises et dont l’organisation est fort réglementaire, ordonne alors à ses fantassins d’attaquer l’ennemi, s’attendant à ce que les Français battent en retraite. Mais combien grande sa surprise lorsque les Prussiens voient courir à leur rencontre une armée disparate de Français de tous âges, d’hommes et de femmes, baïonnette au fusil, qui chargent au cri de “Vive la Nation!”
La débandage de l’armée prussienne et la victoire des Français, dirigés par le général Kellermann et galvanisés par leur engagement idéologique ajouta au concept de stratégie désormais une nouvelle donnée qu’elle n’avait jamais inclue auparavant. La dimension idéologique de la finalité de la guerre concernait désormais la nation, c’est à dire tous les citoyens de l’Etat. Et Hegel a pour sur être influencé par celle nouvelle expérience de la guerre lors de la rédaction de son commentaire sur la Guerre de Trente Ans. C’est par la guerre nationale que s’unissent tous les citoyens de l’Etat.
C’est Napoléon qui savra appliquer avec brio cette nouvelle manière de concevoir le monde. Sur le plan militaire pur, il mettra à profit la force que lui offrait désormais le peuple de la nation entière. Il ne s’agira plus dorénavant de mener des guerres limitées, avec des effectifs limités. Bien su contraire on aura désormais recours à des armées levées sur la base de la conscroption nationale. Tous les jeunes et adultes du pays seront engagés dans l’effort de guerre national, ce qui offrira à Napoléon, pour chaque bataille, des armées de plus de 80.888 soldats. Et c’est précisément grâce à la conscription nationale que Napoléon pourra avoir recours, en toute tranquillité, à sa stratégie d’anéantissement total de l’armée ennemie, après une série de mouvements visant à encercler l’ennemi, pour l’attaquer en suite en son point le plus faible (batailles d’Italie, d’Iéna, d’Austerlitz).
La stratégie militaire est intimement liée, dans le conception napoléonienne, à la stratégie politique, de telle sorte qu’elles seront désormais inséparables. La finalité d’une bataille ou d’une guerre n’est plus, après Napoléon, militaire ou géo-militaire; sa finalité stratégique sera forcément militaro-politique et nationale.
S’il est vrai que Napoléon menait des batailles à travers toute l’Europe, ce n’est pas par hasard. Son élan révolutionnaire lui avait insufflé un projet européen qui était devenu son rêve. Voici ce qu’il confie au ministre Fouché.
“D’ailleurs, qu’y puisje, si un excès de puissance m’entraîne à la dictature du monde? Ma destinée n’est pas accomplie; je veux achever ce qui n’est qu’ébauché. Il nous faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous les peuples de l’Europe le même peuple, et de Paris la capitale du monde. Voilà, Monsieur le Duc, le seul dénovement qui me convienne.”(4)
L’introduction de l’idéologie dans la stratégie militaire fera par la suite son chemin dans des expériences multiples dont les plus caractéristiques sont la variante américaine, avec la Guerre de Sécession *1861 - 2865) et la variante espagnole, avec la Guerre d’Espagne (1936 - 1939).
IV - La stratégie des puissances coloniales
Les puissances coloniales, dont le pouvoir s’est largement étendu entre le 18e et le 20e siècle, ont eu recours à des stratégies navales, considérant que le contrôle des océans et des mers garantissait leur hégémonie propre, chacune dans l’espace géographique qu’elle s’était dessinée. Les nombreuses batailles navales qui eurent lieu entre ces puissances coloniales (Aboukir, Trafalgar, etc.) dénotent combien vitale était alors la suprématie maritime.
La suprématie terrestre, au sein même des colonies, était tributaire de la présence militaire maritime pour ce qui concerne le ravitaillement en hommes et en matériel. Il n’empêche que, malgré la divergence de leurs points de vue, la stratégie adoptée par les Anglais, les Français, les Hollandais, les Belges, les Allemands, les Espagnols, les Portugais et les Italiens était quasiment la même.
Il s’agissait de contôter les pays colonisés militairement afin de pouvoir en tirer profit économiquement. tout était bon pour arriver à cette fin. Les Français se distinguèrent alors par le recours qu’ils firent à la culture et à la langue dans leur pénétration des pays colonisés (nitamment dans le Maghreb et au Liban) tandis que les Anglais eurent davantage recours alors à la répression brutale. Il n’est à ce sujet qu’à se souvenir de la fameuve Guerre de l’Opium (1841-2), menée par la Couronne Britannique contre la Chine.
Comme le pétrole a commencé à jouer, dès le début du 20e siècle, un rôle économique plus important que celui des produits de tissage ou des produits agricoles, les puissances coloniales française et anglaise, en accord avec la puissance américaine montante, ont alors décidé de mettre le Proche-Orient et le Caucase sous leur coupe. C’est ainsi que la bataille ses Dardanelles (1915), menée par les Alliés, n’avait d’autre but que de déstabliser l’Empire Ottoman déclinant, en vue de le remplacer sur le terrain. Les Ottomans ne purent résister à l’assaut que grâce au génie d’un autre Européen, le général allemand Liman von Sanders, chargé par les Ottomans d’organiser la défense turque.
Le même scénario colonial se répétait: des puissances européennes se livraient entre elles une guerre dinfluence, par pays du Sud interposés. Et si l’offensive alliée échoua aux Dardanelles, la stratégie de pénétration militaire anglo-française ne se déclara pas vaincue. Celui qui allait la mettre en application, cette fois-ci à partir de la Péninsule Arabique, fut le colonel britanique T. E. Lawrence, connu sous le nom de Laurence d’Arabie.
Avec une coalition de tribunes bédovines du désert, ce jeune officier va organiser une stratégie de guerilla qui va progressivement mener les combattants arabes, sous la direction du fils du chérif de la Mecque, Faysal, jusqu’à Damas, d’où ce dernier sera plus tard chassé par les Français.
La Guerre du Golfe (1990) n’a nullement modifié cette stratégie première. Elle a uniquement mis l’accent sur le contrôle des richesses en hydro-carbures plutôt que sur la pénétration géo-politique; tout comme elle a permis de remplacer définitivement la puissance européenne par celle des Etats Unis d’Amérique.
C’est ainsi que la stratégie, après avoir servi d’art au service de stratèges géniaux, cherchant à réaliser des projets à dimension géo-militaire limitée, s’est progressivement transformée en une science au service de puissances politico-économiques. Cette science, multiforme, met à profit, souvent à leur insu, les populations autochtones, les incluant avec intelligence dans ses projets stratégiques.
La stratégie est pour cela la résultante de plusieurs sciences, puisque la psychologie sociale y est mise à profit, de même que la technologie, l’anthropologie, la communication de masse et la connaissance scientifique. Le stratège n’est plus un homme, mais une salle d’opérations, et la stratégie une volonté collective et continue adoptée par une puissance capable de mettre en application son projet.
Mais ce qui est de plus en plus caractéristique de nos jours est le fait que la stratégie est façonnée par les superpuissances et appliquée sur les populations à contrôler souvent par des dirigeants autochtones ayant fait le choix du service des intérêts de la puissance étrangère, plutôt que celui des citoyens de leur propre pays.
Reference
(1) CLAUSEWITZ, Cal von, De la Guerre, éd. Perrin, Paris, 1999, p. 79.
(2) Pour une information plus ample sur ce sujet voir: Philippe CONTAMINE, La Guerre de Cent Ans, P.U.F., Paris, 1997, p. 112.
(3) G.W.F HEGEL, Ecrits politiques,: La constitution de l’Allemagne, éd. Champ Libre, Paris, 1977, p. 88.
(4) Frédéric ENCEL, L’art de la guerre par l’exemple, ´d. Flammarion, Paris, 2000, p. 109.