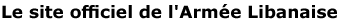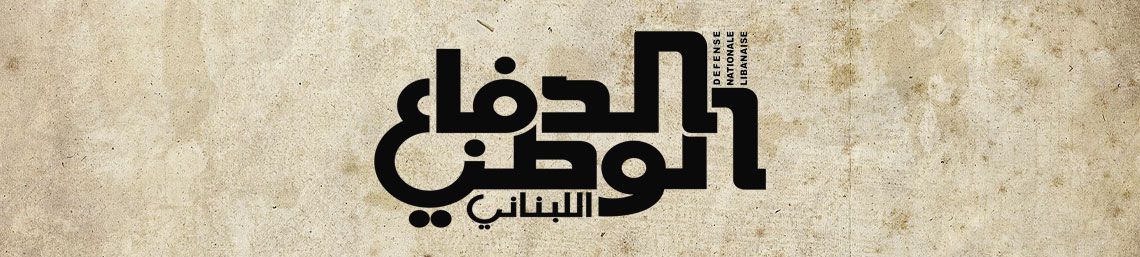- En
- Fr
- عربي
LES LIMITES DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE :Le cas de la cour pénale internationale
Introduction
La justice pénale internationale est un des grands idéaux humains visant à punir les crimes contre l’humanité. Au cours de l’histoire moderne, un certain nombre de tribunaux ont été créés à cette fin, à commencer par le tribunal de Nuremberg et culminant avec la Cour Pénale Internationale, fondée dans le but de juger les individus responsables de crimes de guerre, de génocides, de crimes contre l'humanité, et de crimes d’agression. La chute de l’Union Soviétique a contribué à l’émergence d’un nouvel ordre mondial, entraînant une évolution du droit international dans le sens d’une grande intervention de la communauté internationale dans les affaires intérieures de l’État, comme l’intervention humanitaire armée, le droit de protéger, les droits de l’homme, et le jugement des crimes contre l’humanité. La Cour Pénale Internationale (CPI) est considérée comme l’apogée du nouvel ordre mondial. Toutefois, dès le début, la CPI a été confrontée à un certain nombre de défis, dont les limites de sa compétence, la question de la souveraineté nationale des pays, et les prérogatives d’investigation territoriale de la Cour, l’absence d’une police propre pour arrêter les suspects, et l’influence du contexte politique international. Le rêve de punir les crimes contre l’humanité est une demande légitime et nécessaire, mais reste limité.
1- Souveraineté des États et compétences de la CPI
La souveraineté des États est le fondement du système international1. L’article 2.7 de la Charte des Nations Unies stipule qu’« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII2.»
L’élément clé de la souveraineté de l’État, au sens juridique, consiste en l’exclusivité de la juridiction, de l’usage de la force et l’arbitrage ultime de tous les litiges sur le territoire. Plus précisément, les décisions prises par une entité souveraine ne peuvent être contestées par un autre État. Dès le départ, la compétence de la CPI a soulevé de sérieuses inquiétudes de la part de beaucoup d’États soucieux de leur souveraineté et de l’impact politique potentiel de cette juridiction, car ses décisions sont contraignantes et prévalent sur celles des tribunaux nationaux. De plus, les décisions d’un tribunal international ne sont pas susceptibles d’être révisées ou renversées par un tribunal national3.
En outre, la question de la compétence de la CPI sur les ressortissants de pays tiers non partis de la CPI pose un véritable dilemme, car les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression sont souvent commis avec la collusion des gouvernements. Or, il est presque certain que ces gouvernements ne consentiront pas à la juridiction de la CPI sur leurs ressortissants pour juger les crimes qu’ils ont soutenus ou tolérés.
Selon l’article 12.2 du Statut de Rome, la CPI exerce sa compétence sur un crime commis sur le territoire d’un État ayant déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses ressortissants. La Cour pénale internationale sera également compétente lorsqu’un État qui n’est pas partie au Statut de Rome consent à ce que la CPI exerce sa compétence, s’il s’agit de l’État où le crime a été commis alias l’État du territoire ou de l’État de la nationalité du suspect. Ainsi, l’État de la nationalité de la victime et l’État de détention sont exclus4.
Il en résulte que la compétence de la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de compétence pénale territoriale et non sur la théorie de l’universalité de la compétence, ce qui représente une importante limitation des pouvoirs de la CPI5.
Le consentement de l’État sur le territoire duquel les infractions ont été commises ou dont l’auteur porte sa nationalité est contraire à une notion fondamentale du droit pénal international, qui exige que les personnes responsables d’avoir commis des crimes contre l’humanité ou des génocides doivent rendre compte de leurs actes et doivent être traduites en justice, où qu’elles se trouvent sans qu’aucun consentement ne soit requis de la part d’aucun autre État6.
En outre, l’article 13 du Statut, la Cour « Peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déféré au Procureur par un Etat Partie comme prévue à l’article 14 ; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déféré au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des nations Unies ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. » 7
Ainsi, le Statut de Rome inclut une disposition permettant au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) de renvoyer une situation qui menace la paix et la sécurité internationales à la CPI pour enquête et poursuites. Cette disposition agit comme un acte juridictionnel de déclenchement de la procédure pénale, permettant à la CPI de poursuivre des États non parties contre leur volonté souveraine, indépendamment de toute liaison entre l’État territorial ou de nationalité du suspect et le crime8.
À titre d’exemple, en application de l’article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, après deux mois de discussion, le 31 mars 2005, la résolution 1593 prévoyant que les suspects de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au Darfour, dans l’ouest du Soudan, soient jugés devant la Cour pénale internationale9.
2- Le problème de la complémentarité
Le préambule et l'article 1 du Statut de Rome soulignent que la CPI doit être complémentaire des juridictions pénales nationales, ce qui a établi le principe de complémentarité juridictionnelle de la CPI. En vertu du principe de complémentarité, la CPI n’enquêtera ni ne poursuivra son enquête si un État partie enquête ou poursuit déjà la même affaire10. La CPI n'exerce sa compétence et n'intervient que dans les cas où les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas engager ou mener leurs propres procédures. Ce principe de complémentarité vise à combler les défaillances juridiques pour empêcher les criminels d’échapper aux punitions prévues par le Statut de Rome pour crimes de génocide, contre l'humanité, de guerre et d'agression.
Le principe de complémentarité s'applique non seulement aux États parties, mais également aux États non parties qui ont compétence pour connaître des crimes visés à l'article 5 du Statut, lorsque le crime a été commis par un citoyen d'un État partie sur le territoire d’un État non-partie, ou que le crime a été commis par un citoyen d’un État non partie sur le territoire d’un État partie.
Le procureur de la CPI ou un État partie ne peuvent saisir la Cour que si l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, ou celui dont la personne est ressortissante, est lui-même un État partie.
La compétence pénale nationale prévaut donc sur la Cour pénale internationale. Le principe de complémentarité du droit pénal international exige donc que les États poursuivent eux-mêmes les crimes internationaux et que la CPI ne soit saisie qu'en dernier recours11.
Les conditions de recevabilité du Statut de Rome limitent encore davantage le mandat juridique de la Cour et restreignent sa capacité à répondre aux attentes des défenseurs des droits de l’homme. Outre sa compétence limitée pour juger uniquement le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression, les affaires doivent être considérées comme irrecevables devant la CPI si elles font ou ont fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part des autorités nationales. Cet obstacle peut éventuellement être levé si la Cour prouve que les poursuites nationales ont été engagées dans le but de soustraire l’accusé à la compétence de la Cour pénale internationale, ou si la procédure nationale a été indûment retardée, ou bien encore si elle n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale12.
En outre, la Cour pourra être compétente si elle prouve que l’État est dans l’incapacité de procéder lui-même au jugement en raison de l’effondrement total ou notable ou de la non-disponibilité de son système judiciaire national13.
Lorsqu’aucune enquête de ce type n’a été entreprise ou n’est pas en cours, l’affaire est recevable.
Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour14. La Chambre préliminaire a également un rôle à jouer dans la détermination de la recevabilité. Ainsi, lorsque le Procureur souhaite ouvrir une enquête en vertu de ses pouvoirs, la Chambre préliminaire doit approuver sa décision pour décider d’autoriser ou non l’enquête. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation15. La Chambre préliminaire doit également déterminer la recevabilité des décisions du Procureur de délivrer des mandats d’arrêt et, lorsque la recevabilité est contestée par un accusé ou un État partie, avant l’ouverture d’un procès.
Les conditions formelles de recevabilité énoncées à l'article 17 sont révélatrices d'une approche passive de la complémentarité, dans laquelle la CPI se substitue aux juridictions nationales lorsqu'elles n'agissent pas. Or, selon la CPI « les principes fondamentaux de coopération et de complémentarité au cœur du Statut de Rome sont intimement liés et interdépendants16. » Un cas typique est celui de la CPI et de l’Afghanistan dont le parcours est parsemé d’embuches politiques et juridiques. Ainsi, suite à une requête du Procureur du 20 novembre 2017 aux juges de la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête sur des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés relevant de la compétence de la CPI qui auraient été commis sur le territoire de la République islamique d'Afghanistan concernant le conflit armé qui s'y déroule depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur des crimes similaires qui auraient été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut de Rome depuis le 1er juillet 200217.
La Chambre préliminaire a rejeté la requête du Procureur sous prétexte qu'une ouverture de cette enquête ne servirait pas les intérêts de la justice18. Suite à un appel de cette décision, la Chambre d'appel de la CPI a décidé, dans un arrêt du 5 mars 2020, d'autoriser le Procureur à enquêter sur les crimes présumés commis sur le territoire de la République islamique d'Afghanistan depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur d'autres crimes présumés qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan, sont suffisamment liés à la situation en Afghanistan, et ont été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut depuis le 1er juillet 200219.
En 2020, le gouvernement afghan a demandé un report de l'enquête conformément à l'article 18-2 du Statut de Rome20. Réagissant à cette requête, la Chambre préliminaire a autorisé le procureur à reprendre son enquête, estimant que l'Afghanistan ne menait pas une enquête sérieuse conformément à la demande du 5 mars 2020. Le 4 avril 2023, la Chambre d'appel de la CPI a rendu son arrêt sur l'appel du Procureur et a modifié la décision de la Chambre préliminaire, autorisant la poursuite de l'enquête du Procureur. Après l'annonce de l'enquête, le président américain de l'époque, Donald Trump, a imposé des sanctions au procureur de la CPI et à un proche collaborateur. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis ont été gelés et l'accès au système financier américain leur a été interdit. Si les sanctions ont depuis été levées par le président américain Biden, l'administration américaine a indiqué clairement qu'elle ne soutenait pas l'enquête de la CPI sur l'Afghanistan21.
Or, dans un retournement de situation, le procureur Khan a décidé « d’axer les enquêtes de mon Bureau en Afghanistan sur les crimes qui auraient été commis par les Talibans et l'État islamique de la province du Khorasan, au détriment d'autres aspects de l'enquête. La gravité, l'ampleur et la nature des crimes qu'auraient commis ou que commettraient les Talibans et l'État islamique, notamment les allégations faisant état d'attaques aveugles contre des civils, d'exécutions extrajudiciaires ciblées, de persécutions à l'égard des femmes et jeunes filles, de crimes commis contre les enfants ainsi que d'autres crimes touchant la population civile dans son ensemble, exigent l'attention de mon Bureau et le déploiement de ressources adéquates afin de bâtir des dossiers solides et de prouver la culpabilité des accusés à l'audience au-delà de tout doute raisonnable22.» Cette décision constitue un retour en arrière et suggère une soumission aux pressions politiques américaines. D'ailleurs, l'enquête est en suspens et traîne depuis plus de 20 ans sans aucun résultat tangible.
En fait, le problème de la complémentarité est lié à la volonté politiques des états de coopérer avec la CPI comme le souligne la stratégie d’ensemble du procureur. « Il est clair que l’on ne peut procéder à aucune enquête sans avoir apprécié avec soin l’ensemble des circonstances prévalant dans le pays ou la région concernée… En cela ils soulignent la nécessité pour le bureau du procureur de pouvoir compter sur le soutien des états lorsqu’une enquête est ouverte. Autrement dit, le Procureur a besoin du soutien de forces nationales ou internationales pour pouvoir être en mesure de conduire des enquêtes sur le terrain…De fait, ce sont les états eux-mêmes qui ont accès aux éléments de preuves et de témoignages. »23
3- Défis politiques et doutes sur l’application des mandats
Le contexte politique international constitue un important défi au succès de la CPI. Outre l'échec flagrant de la tentative d'arrestation de l'ex-président soudanais Omar al-Bashir, la guerre de Gaza et autres mandats d'arrêt constituent un grand défi pour la CPI.
L'un des revers les plus flagrants de la CPI est l'échec des poursuites contre l'ex-président soudanais Omar al-Bashir visant à son arrestation. Ce dernier avait créé la milice Janjaweed, formée de membres de tribus arabes, pour réprimer violemment une insurrection dans la province du Darfour. Cette opération a entraîné la mort de 300 000 victimes civiles et le déplacement de 3 millions de personnes.
En réponse à ces atrocités perpétrées au Darfour, une enquête lancée par une commission d'enquête de l'ONU a conclu que les troupes de Bashir s'étaient livrées à de graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, équivalant à des crimes au regard du droit international. La commission d'enquête a recommandé au Conseil de sécurité de l'ONU de soumettre l'affaire à la CPI. Après deux ans d'enquête, la CPI a conclu que Bashir était responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
Un premier mandat d'arrêt contre Omar al-Bashir a été délivré le 4 mars 2009, suivi d'un second le 12 juillet 2010. Les charges comprenaient cinq accusations de crimes contre l'humanité : meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol, et deux chefs de crimes de guerre : le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, et pillage; trois chefs de génocide : par meurtre, par atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, et par soumission intentionnelle de chaque groupe ciblé à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Ces crimes auraient été commis de 2003 à 2008 en partie au Darfour, au Soudan24.
Cependant, le mandat d'arrêt contre Omar al-Bashir n'a pas pu être exécuté. Ce dernier a pu se rendre en toute impunité dans un certain nombre de pays, comme le Kenya et le Tchad. Après la chute du régime de Bashir, le Soudan a annoncé qu'il allait livrer tous les suspects recherchés à la CPI, mais le transfert n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. Après trois mois de manifestations, l’armée destitue Bashir et l’arrête le 11 avril 2019. Au lendemain de sa destitution, l’armée annonce qu’il ne sera pas extradé mais qu’il sera jugé au Soudan. Quelques jours plus tard, l’armée annonce que la décision de son transfert à la CPI sera tranchée par le prochain gouvernement élus. Les autres suspects demeurent en fuite sans être arrêté le Soudan ayant sombré dans une violente guerre civile.
Suite aux graves violations du droit humanitaire à Gaza, le procureur de la CPI, Karim Khan, a présenté en date du 20 mai 2024 des requêtes pour obtenir des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza25. Ces accusations portaient sur :
- « Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre en tant que crime de guerre, en violation de l'article 8 2 b xxv du Statut ;
- Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, en violation de l'article 8 2 a iii ou les traitements cruels en tant que crime de guerre, en violation de l'article 8 2 c i ;
- L'homicide intentionnel, en violation de l'article 8 2 a i ou le meurtre en tant que crime de guerre, en violation de l'article 8 2 c i ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que crime de guerre, en violation des articles 8 2 b i ou 8 2 e i ;
- L'extermination et/ou le meurtre en tant que crime contre l'humanité, en violation des articles 7 1 b et 7 1 a, y compris en lien avec le fait d'affamer des civils ayant entraîné la mort, en tant que crime contre l’humanité ;
- La persécution en tant que crime contre l'humanité, en violation de l'article 7 1 h ;
- D'autres actes inhumains en tant que crime contre l'humanité, en violation de l'article 7 k »26.
Ce n'est pas la première fois que le dossier palestinien arrive devant la CPI. En 2008, l'autorité palestinienne a demandé au procureur Ocampo d'ouvrir une enquête pour des allégations de crimes de guerre. Mais l'affaire n'a pas été jugée recevable car l'autorité palestinienne n'avait pas le statut d'État non-membre de l'ONU. La deuxième affaire, initiée par Fatou Ben souda, portait sur la colonisation israélienne. Cependant, face aux pressions, elle a demandé aux juges de confirmer la compétence territoriale de la juridiction. En février 2021, la Chambre préliminaire a confirmé que la juridiction de la CPI s'étend à tout le territoire palestinien. L'enquête a officiellement commencé en mars 2021.
Les requêtes du procureur pour l'émission de mandats d'arrêt ne signifient pas que ceux-ci seront officiellement émis. En effet, conformément à l'article 58 du Statut de Rome, ce sont les juges de la Chambre préliminaire qui décideront, au vu du sérieux des requêtes du procureur, de donner suite ou non. Ils peuvent refuser d'émettre un mandat d'arrêt contre une ou plusieurs des personnes visées et également décider de ne pas retenir l'ensemble des charges.
Si ces mandats d'arrêt venaient à être confirmés, Netanyahou figurerait sur la liste des chefs d'État en exercice dont la CPI a demandé l'arrestation. D'autre part, les conséquences de l'émission des trois mandats d'arrêt visant les leaders du Hamas seraient nettement moins lourdes pour les responsables palestiniens, car ceux-ci se déplacent rarement dans des États parties au Statut de Rome.
Dans le cadre de la demande de mandats d'arrêt à l'encontre de responsables israéliens et palestiniens, la Cour pénale internationale (CPI) a autorisé plus de 60 États, organisations et individus à "présenter des observations en qualité d'amicus curiae", des parties qui assistent le tribunal en fournissant des informations ou des conseils juridiques.
La requête du procureur rencontrera probablement de nombreuses contestations juridiques et politiques pour empêcher son exécution, ce qui sapera davantage la crédibilité de la CPI. Il existe de sérieux doutes sur la possibilité que la requête du procureur soit suivie d’effets dans la pratique en raison des pressions politiques et de contestations procédurales de toute sorte.
Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale ("la CPI" ou "la Cour") a délivré des mandats d'arrêt contre le Président russe Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits de l'enfant en Russie. La CPI a émis ces deux mandats d'arrêt sans les rendre publics pour protéger à la fois les victimes et les témoins ainsi que les besoins de l'enquête. Ces mandats d'arrêt concernent des crimes de guerre liés à la déportation illégale ou au transfert illégal d'enfants de l'Ukraine vers la Russie depuis le 24 février 2022, incriminés par l'article 8(2) (a) (vii) du Statut de la CPI. En outre, pour la Cour, le président Poutine encourt une responsabilité pénale individuelle pour ces crimes en tant qu'auteur au titre de l'article 25(3)(a) du Statut de la CPI ou en tant que supérieur hiérarchique au titre de l'article 28(b) du même Statut. Il lui est également reproché de ne pas avoir exercé un contrôle opportun sur ses subordonnés civils ou militaires qui ont commis ces crimes alors qu'ils étaient sous son autorité et son contrôle indiscutable. D'autre part, le mandat émis contre Maria Lvova-Belova la vise uniquement en tant qu'auteur27.
Doutes sur l'application des mandats
Il y a un grand doute que ces mandats soient appliqués. Tout d'abord, il existe une grande division politique autour du sujet. La majorité des premières réactions d'approbation sont venues des pays occidentaux, alors que la plupart des États africains et une grande partie des pays du Sud sont restés indifférents ou hostiles à cette décision. Pour cela, il est improbable qu’elle soit suivie d’effets pratiques.
Cette accusation est plutôt symbolique car difficilement applicable. La délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un chef d'État en exercice, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est une étape sans précédent pour la CPI. En effet, les grandes puissances comme la Russie bénéficient généralement d'une immunité de facto dans les enquêtes de la CPI, comme dans les cas de la Géorgie et de l'Ukraine avant 2022, et lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. De même, le droit de veto des grandes puissances, dont la Russie, crée un grand déséquilibre dans le système international. En somme, la CPI doit démontrer qu'elle peut enquêter et poursuivre des faits concernant une grande puissance, qui est de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.
Enfin, la CPI ne dispose pas de forces de police propres pour exécuter ces mandats d'arrêt. C'est aux États parties qu'il incombe d'exécuter ces mandats si les personnes visées se trouvent sur leur territoire. Leur adhésion au Statut de la CPI leur confère en effet l'obligation d'exécuter les décisions prises par celle-ci, comme ses mandats d'arrêt.Cette arrestation n'est pas si sûre, car un État partie peut préférer, pour des raisons politiques, s'abstenir de le faire malgré l'obligation qui lui incombe du fait du Statut de la CPI. Cela est arrivé dans le passé avec le mandat d'arrêt délivré contre le Président du Soudan, M. Omar Al-Bashir. Celui-ci au cours de son Mandat présidentiel a visité plusieurs États parties sans avoir été inquiété.
4- La crédibilité de la Cour pénale internationale
Malgré un progrès évident depuis le tribunal de Nuremberg, la justice pénale internationale, représentée par la CPI, est handicapée par de nombreuses contraintes juridiques et politiques.
Tout d'abord, presque toutes les personnes mises en accusation pour des crimes prévus par la CPI sont africaines, à tel point que les poursuites contre Al-Bashir ont irrité un certain nombre de pays africains comme le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie, qui ont brandi la menace de cesser d'être des États parties de la CPI28. À ce propos, l'Union africaine a affirmé que "la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l'impunité qu'en Afrique, comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase29." D'autres personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques évidentes, comme l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a été acquitté après près de dix ans de procédure. Un autre exemple est celui de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, qui a été acquitté en 2018, deux ans après avoir été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
En outre, le procureur de la CPI, Karim Khan, a été très lent à agir dans son enquête sur les atrocités présumées commises par les États-Unis en Afghanistan et dans le cas du Myanmar. Il a également clos des enquêtes en Géorgie30 et en République centrafricaine, ce qui a suscité une vive controverse31.
L'enquête sur la guerre de Gaza du 7 octobre suscite également beaucoup de controverses. Ainsi, les États-Unis ont clairement signalé que l'attaque de Gaza du 7 octobre ne relevait pas de la compétence de la CPI. En effet, selon les États-Unis, la CPI, telle que créée au départ, est un tribunal aux compétences limitées ancrées dans des principes de complémentarité. Ces derniers, selon les États-Unis, ne semblent pas avoir été appliqués, le procureur s'étant empressé de demander ces mandats d'arrêt "au lieu de donner au système juridique israélien la possibilité d'agir pleinement et en temps voulu. Dans d'autres situations, le procureur s'est en effet remis aux enquêtes nationales et a collaboré avec les États pour qu'ils aient le temps d'enquêter. Le procureur n'a pas donné la même possibilité à Israël, qui a déjà ouvert des enquêtes portant sur des allégations contre son personnel32."
En revanche, le nouveau gouvernement élu en Grande-Bretagne a renoncé à la requête du précédent cabinet pour examiner si la Cour pénale internationale peut exercer sa juridiction sur des ressortissants israéliens afin d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Tout cela démontre l'importance de l'aspect politique dans la saisine de la CPI.
Au plan politique, les grandes puissances n'ont pas ratifié le Statut de la CPI, comme la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis. Chaque État a ses propres raisons de ne pas ratifier, mais leur préoccupation principale est la responsabilité découlant de cette ratification. Or, en l'absence de ces grandes puissances, l'efficacité de la CPI est mise à mal et les États sont moins susceptibles de coopérer avec une organisation internationale qui ne peut pas faire appel à l'appui des grandes puissances pour l'aider à exécuter les mandats d'arrêts de la Cour.
Un autre exemple significatif est celui de l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la CPI. Depuis plus de 25 ans, les relations des États-Unis avec la Cour pénale internationale (CPI) ont oscillé entre soutien idéaliste et franche hostilité. Ainsi, le président Bill Clinton a signé le Statut de Rome le dernier jour avant l'expiration de la date des signatures, le 31 décembre 2000. Par la suite, le président George Bush a retiré la signature des États-Unis du Statut de Rome.
La même année, une loi intitulée American Service-Members Protection Act permet de soustraire de la compétence de la CPI les ressortissants américains résidant sur leur territoire d'origine ainsi que ceux qui seraient éventuellement remis par un autre État à la Cour. Le président Obama adopte une position plus constructive vis-à-vis de la CPI, sans pour autant signer le traité d’adhésion à la CPI.
Les choses se durcissent à nouveau sous le président Donald Trump. En effet, le 5 mars 2020, la Cour ayant décidé d’ouvrir une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Afghanistan, le secrétaire d’État Mike Pompeo qualifie la Cour d'institution politique irresponsable, ajoutant que les États-Unis prendront les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et le peuple américain. En juin 2020, le président Donald Trump signe un ordre exécutif imposant des sanctions économiques et des restrictions de visas applicables au personnel de la Cour et à leur famille.
En avril 2021, le président Joe Biden révoque le décret signé par son prédécesseur qui mettait en place des sanctions contre le personnel de la Cour, mais reste néanmoins toujours opposé aux enquêtes relatives à l'Afghanistan et à Israël. Ensuite, le soutien américain à la CPI s'était accru avec l’enquête sur l’Ukraine, mais il est à nouveau en train de s’effriter après les poursuites engagées contre des dirigeants israéliens.
Ainsi, le président Biden a indiqué que la décision de la CPI était justifiée, qu’elle envoyait un signal très fort et que le gouvernement américain allait soutenir activement l'enquête de la CPI sur l'Ukraine. La CPI peut désormais enquêter sur le territoire américain, mais uniquement dans le cadre de l’enquête sur l’Ukraine. À l'inverse, le gouvernement américain va probablement continuer à s’opposer à l’enquête de la Cour sur la Palestine, mais il pourrait soutenir la CPI au Myanmar ou une enquête sur les accusations de meurtres attribués au groupe russe Wagner dans plusieurs pays africains où la CPI enquête déjà. Tous ces soubresauts démontrent que la politique prime sur la recherche de la justice.
L’aspect politique est également visible dans l’article 16 du Statut de Rome qui stipule que le Conseil de sécurité est investi du pouvoir de surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale pendant une durée de 12 mois, indéfiniment renouvelable. En effet, il pourra demander à la CPI de ne pas engager ou de suspendre des enquêtes ou des poursuites sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En réalité, l’article 16 accorde un pouvoir de contrôle politique du Conseil de sécurité sur la CPI, surtout que le Conseil de sécurité est un organe politique et non judiciaire. Par conséquent, la sphère d’action de la Cour pénale internationale ainsi que son autonomie même se trouvent largement réduites.
En outre, la juridiction de la CPI repose sur la coopération des États. Une saisine pure et simple de la CPI n’est pas facile, comme dans le cas libyen ou celui de la Côte d’Ivoire. La tournure prise par les événements dans le cas de la Libye, qui a conduit à un changement de régime, a poussé la Russie et la Chine à s’opposer à une intervention militaire en Syrie.
Selon le Statut de Rome, les États qui ne sont pas parties au Statut n'ont pas l'obligation de procéder à une arrestation requise par la CPI. Cependant, la résolution du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci saisit la CPI demande instamment à tous les États de coopérer avec la Cour.
Un effet dissuasif ?
La CPI n’a pas été dissuasive. Pour le démontrer, il suffit de dresser la liste de tous les massacres commis depuis sa création et restés impunis. Or, la plus grande limitation juridique de la Cour est qu’elle ne dispose d’aucun moyen propre pour garantir l’arrestation et la remise des suspects, même si les États parties ont l’obligation légale d’arrêter les personnes inculpées sur leur territoire. Leur volonté et leur capacité à le faire sont souvent discutables. En outre, la capacité de la Cour et les ressources limitées dont elle dispose, le faible nombre de personnes poursuivies et la sélectivité des choix suggèrent aux criminels que le risque d’être poursuivi est souvent limité, donc peu dissuasif. Or, pour que cette dissuasion globale fonctionne, il faudrait que la justice pénale internationale soit vraiment perçue comme crédible.
Conclusion
La CPI a été créé pour juger les individus responsables des crimes de guerre, des génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes d’agression. La question qui se pose est celle de savoir si la Cour a répondu aux atteintes des défenseurs des droits humain. En 1872, le citoyen suisse Gustave Moynier, successeur immédiat d'Henry Dunant, rédige le premier texte des statuts d'une cour pénale internationale. Ses vœux ont-ils été exaucés33. En réalité, malgré un progrès significatif, un certain nombre d’obstacles politiques et juridiques freinent le travail de la CPI.
Tout d’abord, la compétence de Cour est assez limitée car elle ne possède pas une compétence générale sur toutes les atteintes aux droits de l’homme et le terrorisme ? Sur le plan politique, la compétence territoriale de la CPI n'est pas universelle en vertu du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le droit de veto au Conseil de sécurité et les intérêts politiques poussent parfois les États à privilégier leurs intérêts plutôt que la justice. Ainsi, dans l’histoire, des violations des droits de l’homme étaient généralement passées sous silence pour des raisons politiques. En poursuivant sa tâche, la Cour sera donc presque inévitablement prise entre les pôles d’une politique de puissance brutale d’un côté et les droits de l’homme de l’autre. Certains ajustements au Statut de Rome peuvent améliorer le fonctionnement de la Cour, comme la clarification des textes relatifs à la question de la souveraineté des États, les mesures à prendre au cas où des États membres refusent de coopérer avec la CPI, la clarification des questions de l’immunité, de l’admissibilité et du droit applicable34.
En somme, il existe un besoin urgent de justice dans les cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et le droit international doit y contribuer impérativement au-delà de toute considération politique ou autre. La mondialisation des médias et la multiplication des ONG depuis les années 1990 ont conduit à un examen plus minutieux du bilan des violations graves des droits humains commises par les États. Cette surveillance accrue des actions de l’État en matière de droits de l’homme démontre qu'un changement perceptible est en train d’émerger, visant à redéfinir la souveraineté en termes d’obligations des États dans le domaine du droit humanitaire. Il est important de continuer à œuvrer pour créer une cohérence juridique entre les ordres judiciaires nationaux et le champ de compétence de la CPI, de pallier la lenteur de ses procédures, de limiter l’impact politique sur ses activités pour aboutir à une Cour plus effective et indépendante.
Références
1. Albert, J., (dir.), L'avenir de la justice pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2024.
2. Becqaurt, A., La clef d’un système global de lutte contre l’impunité des crimes internationaux : le principe de complémentarité, Paris, Pedone, 2024.
3. Bellivier, F, I. Fouchard, M. Eudes, Droit des crimes internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, Thémis, 2018.
4. Findlay, M., & Henham, R., Transforming International Criminal Justice: Retributive and Restorative Justice in the Trial Process, Cullompton, Willan Publishing, 2005.
5. Flore, D., Droit pénal européen, Paris, 2022.
6. Hernandez, J., Droit international pénal, Paris, LGDJ, 2022.
7. Koudé, R., La justice pénale internationale : un instrument idoine pour raisonner la raison d’état ? Paris, L’Harmattan, 2023.
8. Maison, R., Justice pénale internationale, Paris, PUF, 2017.
9. Mathilde Philip-Gay, Peut-on juger Poutine?, Albin Michel, 2023.
10. Puigelier, C., Apprendre en synthétisant, le crime international, Paris, 2024.
11. Rebut., D, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 2022.
12. Henham, R. J., Punishment and Process in International Criminal Trials, Ashgate Publishing Ltd., 2005.
13. Peltier, N., Ethique et justice internationale, Paris, L’Harmattan, 2021.
14. Rapport annuel du Bureau du Procureur, https://www.icc.cpi.intOTP annual-report-fra.
15. Tribolo-Ferrand, J., La confiance dans les procédures, devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2022.
16. Zozime, A., Tamekamta, J., Tchindo Kenfo, J., La cour pénale internationale, Paris, Québec, Presse Universitaire du Québec, 2022.
17. William Schabas, The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2016