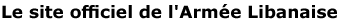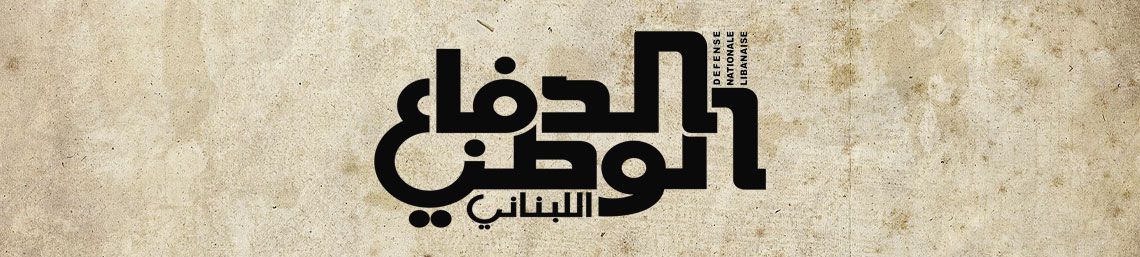- En
- Fr
- عربي
La protection des biens culturels en droit international
Introduction
Les biens culturels constituent le fondement vivant de l'identité, de la dignité et de la continuité intergénérationnelle. La communauté internationale se doit de les protéger en adoptant les mesures juridiques et institutionnelles nécessaires, sous peine d’assister à l'effacement de plusieurs millénaires de civilisation, soit par la guerre et la violence, soit en temps de paix, ou pour des considérations politiques. La Convention de La Haye de 1954, constitue le principe de la protection des biens culturels. Il s'agit du premier traité international consacré à la sauvegarde du patrimoine culturel en temps de paix et en temps de guerre. L’article 3 de la Convention oblige les États à prendre des mesures préventives pour la sauvegarde des sites culturels en cas de conflit armé. Ces mesures comprennent l’établissement d’inventaires, la création de plans d’intervention d’urgence et la mise en place de protections juridiques au niveau national. De plus, l’article 5 de la convention interdit l’utilisation des sites culturels à des fins militaires, soulignant l’importance de préserver l’intégrité du patrimoine en temps de paix comme en temps de guerre. La Convention de La Haye de 1954 et la Convention du Patrimoine mondiale de l’UNESCO de 1972 ont fourni le cadre essentiel pour la protection du patrimoine culturel mondial. Ils encouragent la coopération internationale, sensibilisent et établissent des normes mondiales, toutes considérées comme bénéfiques. Toutefois, ces Conventions doivent renforcer les mécanismes de contrôle et de sanctions pour les atteintes au patrimoine culturel et naturel mondial.
Conventions internationales sur la protection des biens culturels
A. La Convention de La Haye et ces deux Protocoles
La pierre angulaire de la protection des biens culturels en temps de guerre est la Convention de l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés plus connue sous le nom de Convention de La Haye de 1954.2 Il s'agit du premier traité international consacré à la sauvegarde des biens culturels en temps de conflit armé. Elle stipule que toute atteinte aux biens culturels d'un peuple constitue une atteinte au patrimoine culturel de l'humanité tout entière. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels définit, dans son article premier, les biens culturels comme suivant:
a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ; b) les édifiés, c'est dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a) ; c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits « centres monumentaux ».3
Cette définition est suffisamment souple pour englober de nouvelles formes de biens culturels, jusque-là méconnues ou inimaginables en 1954, comme les archives cinématographiques.
Les États parties s'engagent à respecter les biens culturels en s'abstenant de les utiliser à des fins militaires ou de les prendre pour cible pendant les hostilités, et à prendre des mesures de sauvegarde telles que la préparation d'inventaires et la construction d'abris de protection en temps de paix. La Convention a également créé l'emblème distinctif du Bouclier bleu pour marquer les sites culturels et le personnel protégés.4
Deux protocoles renforcent la Convention de La Haye. Le Premier Protocole (1954) interdit l'exportation de biens culturels des territoires occupés et impose la restitution des objets illicitement retirés après un conflit.5 Le Deuxième Protocole (1999), adopté en réponse aux conflits contemporains, renforce la protection des biens culturels et l'application de la Convention. Il introduit le concept de protection renforcée pour le patrimoine culturel de grande importance accordée par un comité international et précise la responsabilité pénale individuelle pour les violations graves.6
En vertu du Deuxième Protocole, diriger des attaques contre des biens culturels ou les utiliser à l'appui d'une action militaire peut être poursuivi en tant que crime de guerre. L’ensemble de ses instruments constituent le régime juridique fondamental des biens culturels en temps de guerre.
B. La Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adopté par l’UNESCO en 1972. Ce traité a créé la Liste du patrimoine mondial, reconnaissant les sites d'une « valeur universelle exceptionnelle » et obligeant les États parties à les protéger et à les préserver en tant qu'éléments du patrimoine mondial.7
L’article 1 de la Convention définit le patrimoine culturel comme « les monuments, les ensembles architecturaux et les sites ayant une valeur historique, esthétique, archéologique, scientifique, ethnologique ou anthropologique ».8
L’article 3 ajoute qu’il appartient à chaque État partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire, mentionnés aux articles 1 et 2. Les Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées.
L’article 4 stipule que « Chaque État partie reconnaît que le devoir d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur son territoire lui incombe en premier lieu. »9
L’article 5 stipule que « Afin de garantir que des mesures efficaces et actives soient prises, chaque État partie s’efforce d’adopter une politique générale visant à donner au patrimoine culturel et naturel une fonction dans la vie de la communauté et à intégrer la protection dans des programmes d’aménagement du territoire. »10
L’article 11 prévoit également l’établissement de la Liste du patrimoine mondial et d’une Liste du patrimoine mondial en péril.11 De plus, les États membres (États parties) sont encouragés à identifier et proposer l'inscription de biens de « valeur universelle exceptionnelle » sur la Liste du patrimoine mondial.
Si la Convention du patrimoine mondial est axée sur la conservation en temps de paix par le biais de mesures de protection nationales, de plans de gestion et d'assistance internationale, elle devient également pertinente en période de conflit. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO peut aussi inscrire des sites sur la liste du « patrimoine mondial en péril » afin de mobiliser des ressources lorsque des sites sont confrontés à des menaces telles que la guerre. La Convention de 1972 complète ainsi le droit en temps de guerre en valorisant des sites clés et en créant un cadre de coopération internationale pour leur protection.
C. La Convention de l'UNESCO sur l’Exportation et l’Importation illicites des biens culturels
Un autre pilier de la protection en temps de paix comme en temps de guerre est la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Ce traité aborde le problème du pillage et du trafic illicite d'antiquités, un problème exacerbé par les conflits armés lorsque des sites sont pillés et des objets passés en contrebande. La convention oblige les États à réglementer les exportations, à contrôler les marchés de l'art et à restituer les biens culturels volés. L’article 3 de la Convention considère comme illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties de la présente Convention.12 Afin d’assurer la protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, les États parties de la Convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants.13
D. Les autres instruments pertinents de protection des biens culturels
Plusieurs autres instruments internationaux renforcent la protection du patrimoine culturel. Les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève contiennent des dispositions (article 53 du Protocole I) interdisant les actes hostiles contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte lors de conflits armés internationaux. Concernant les conflits internes, le Protocole II interdit également les attaques contre les biens culturels, quoique dans une portée plus limitée. Ces dispositions renforcent le fait que, même en dehors de la Convention de La Haye, attaquer des sites culturels peut constituer une violation du droit international humanitaire.
Si les Conventions de Genève se concentrent principalement sur la protection des civils en temps de guerre, leurs Protocoles additionnels renforcent l'importance de la protection des biens culturels, qui bénéficient de la même protection que tous les biens civils. Ils réaffirment qu'il est strictement interdit d'attaquer ces sites ou de les utiliser à des fins militaires, mais qu'ils constituent une cible légitime s'ils sont utilisés à des fins militaires, comme le stipule l'article 53 du Protocole additionnel I.
« Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954 et des autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :
a) de commettre des actes d'hostilité dirigés contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;
c) de faire de ces biens l'objet de représailles. »14
Le Protocole additionnel II définit également cinq actes considérés comme des violations graves engageant la responsabilité pénale des individus conformément à l'article 15 du Protocole ;
« Les violations graves qui nécessitent une sanction pénale si elles sont commises intentionnellement et en violation de la Convention de 1954 ou du Protocole II :
a) de faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque ;
b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée à l’appui d’une action militaire.
c) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalismes dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. »15
Enfin, le droit international et le droit international coutumier imposent également aux puissances occupantes l'obligation de protéger les biens culturels sous leur contrôle contre le vol et le détournement.
Selon la règle 41 de l'Étude du CICR (Comité Internationale de la Croix Rouge) sur les règles coutumières du droit international humanitaire, la puissance occupante doit empêcher l'exportation illicite de biens culturels du territoire occupé et restituer les biens exportés illicitement aux autorités compétentes du territoire occupé.16
En outre, la Convention UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés et divers accords régionaux prévoient des mécanismes de restitution des biens culturels17. En outre, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) qualifie de crimes de guerre les attaques intentionnelles contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'éducation, à l'art, à la science ou aux monuments historiques, dans les conflits internationaux et non internationaux à condition qu'il ne s'agisse pas d'objectifs militaires. Cela a été clairement démontré en 2016 lorsque la CPI a poursuivi et condamné un individu pour la destruction du patrimoine culturel à Tombouctou, au Mali, en considérant cette destruction comme un grave crime de guerre.
Enfin, des déclarations de l'UNESCO et les résolutions des Nations Unies ont été prises en réponse aux attaques contre les biens culturels. Ainsi, après la destruction des statuts du Bouddhas de Bamiyan par les Talibans en 2001 qui a choqué le monde, l'UNESCO a adopté en 2003 une Déclaration concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, affirmant que les États et la communauté internationale ont l'obligation de protéger le patrimoine contre toute destruction injustifiée, même en temps de paix. Plus récemment, la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité de l'ONU, suscitée par les attaques de Daech contre le patrimoine culturel au Moyen-Orient, appelle les États à protéger le patrimoine culturel du terrorisme et des conflits, signalant que la protection du patrimoine est désormais considérée comme une question de sécurité internationale.
Études de cas
A. Liban
Le Liban a inscrit au patrimoine mondial six sites : Anjar, Baalbek, Byblos, Tyr, la vallée de la Qadisha/les Cèdres de Dieu et la Foire internationale Rachid Karami à Tripoli. En 2023-2024, le patrimoine culturel du Liban a été menacé par les répercussions d’un conflit régional : la guerre entre “Israël” et le Hamas à Gaza s’est étendue au sud du Liban. Dans ce contexte, le ministère libanais de la Culture a lancé un appel urgent à l'aide de l'UNESCO, affirmant que les protections symboliques nationales, comme l'emblème du Bouclier bleu, ont montré une efficacité limitée face aux bombardements intensifs. Cette décision de l'UNESCO a notamment été également prise à la demande des autorités libanaises et suite à l'appel de centaines d'archéologues et d'universitaires qui ont appelé à l'activation du mécanisme de protection renforcée. Cela a directement conduit à la session extraordinaire du Comité de l'UNESCO à Paris le 30 octobre 2024 et à la décision d'accorder une protection renforcée provisoire aux 34 biens culturels libanais.18
L'inscription sur la liste de protection renforcée de l'UNESCO signifie que ces 34 sites bénéficient désormais du plus haut niveau de protection contre les attaques et l'utilisation à des fins militaires. Concrètement, ce statut est accordé en vertu du Deuxième Protocole (1999) de la Convention de La Haye et signale à toutes les parties à un conflit que ces sites ne peuvent pas faire l’objet d’attaques délibérées ou d'utilisation militaire. Le non-respect de ces dispositions – par exemple, le bombardement intentionnel de l'un de ces sites marqués ou l'utilisation d'un monument protégé comme caserne militaire – constituerait une « violation grave » du droit international et pourrait donner lieu à des poursuites pour crimes de guerre. La décision de l'UNESCO, prise en novembre 2024, d'inscrire 34 sites sur la Liste du patrimoine mondial s'est accompagnée d'engagements d'assistance technique et financière visant à l'amélioration de la préparation aux risques et à la formation des gestionnaires de ces sites. Il s'agit d'un engagement international proactif en faveur du patrimoine culturel libanais dans un contexte de crise, et cela souligne l'intégration de la conservation du patrimoine en temps de paix aux interventions d'urgence en temps de guerre. Pourtant, lors des affrontements de 2024, certains sites historiques ont été endommagés ou réduits en ruines, ou souffert de dommages collatéraux, malgré leur statut de protection.19
B. Afghanistan : Bouddhas de Bamiyan
La destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans était un acte calculé de nettoyage culturel, représentant l'un des échecs les plus emblématiques de la communauté internationale à empêcher une perte irréversible du patrimoine. Malgré les menaces explicites des talibans et les appels d'urgence de l'UNESCO début 2001, aucune mesure préventive efficace n'a été déployée.
Bien que cet acte ait été largement condamné et que l'Assemblée générale des Nations Unies ait adopté une résolution condamnant la destruction, ces déclarations sont restées des déclarations sans effet.20 Suite à cela, plusieurs pays et l'UNESCO ont proposé de reconstruire les Bouddhas ou de préserver les niches comme mémorial.
C. Irak
L'État islamique d'Irak et du Levant (EIIL) a mené entre 2014 et 2017 une campagne délibérée et dévastatrice de génocide culturel en Irak, ciblant des sites archéologiques, des sanctuaires religieux et des institutions culturelles. Le groupe a détruit le musée de Mossoul, dynamité la ville antique de Nimroud, rasé les ruines d'Hatra et profané le tombeau du prophète Jonas.
Les résolutions 2199 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenté de criminaliser et de mettre un terme au commerce illicite d'antiquités en provenance d'Irak et de Syrie, mais leur mise en œuvre reste fragmentaire.
Pour sa part, L'UNESCO a envoyé des missions d'experts pour évaluer les dégâts et a collaboré avec INTERPOL pour localiser les objets pillés et a lancé des campagnes de sensibilisation du public. Avec les autorités irakiennes et d'autres organisations internationales, l'UNESCO a facilité la création d'inventaires, la formation du personnel du patrimoine et des initiatives de réhabilitation. De plus, après la libération de Mossoul, l'UNESCO a mené la campagne « Revivre l'esprit de Mossoul », son initiative la plus ambitieuse de reconstruction du patrimoine post-conflit. Elle visait non seulement à restaurer des monuments culturels, mais aussi à restaurer l'identité communautaire à travers le patrimoine. Malgré l’importance de ces initiatives beaucoup reste à faire.
Défis de l’application des Conventions
La Convention de La Haye de 1954 et la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972 ont été créées pour protéger le patrimoine culturel respectivement en temps de guerre et en temps de paix. En dépit de leur grande importance juridique, leur application concrète reste limitée même si ces Conventions sont contraignantes et imposent des obligations aux États membres en cas de conflit armé.
En effet, l’application de la Convention de La Haye de 1954 dépend largement de la volonté des États d'appliquer ses dispositions. Elle a été renforcée par le Deuxième Protocole de 1999, qui a introduit le principe de la responsabilité devant les tribunaux internationaux. Cependant, le Protocole n'est pas largement ratifié et son application reste limitée, notamment à l'encontre des acteurs non étatiques, qui opèrent souvent hors de sa juridiction.
La Convention de la Haye de 1954 et la Convention de l'UNESCO de 1972 appellent à la reconnaissance et la conservation du patrimoine culturel en temps de paix. Ces traités ont été efficaces pour sensibiliser et financer, mais leur application est insuffisante. L'UNESCO s'appuie sur des mécanismes tels que la pression publique et la menace de radiation, qui sont également insuffisants lorsque les considérations politiques ou économiques prennent le pas sur les préoccupations culturelles.
Dans l'ensemble, ces traités représentent une étape importante pour la protection culturelle, mais ils demeurent insuffisants. Il est urgent de mettre en place des procédures plus robustes, plus contraignants et inclusives, capables de fonctionner en temps de paix ou de conflit et d’éviter de les contourner le système.
A-Définitions floues des conventions
Le premier problème à soulever, notamment dans les protocoles additionnels, est la définition floue donnée aux biens culturels. Bien que la Convention de 1954 interdit les attaques contre les biens culturels, il n'existe aucune définition détaillée de ce que sont ces biens culturels, ni de ce qui constitue exactement le patrimoine culturel ou spirituel, ce qui entraîne inévitablement des divergences d'interprétation. Par ailleurs, si la règle constitue bien sûr la protection ultime, l'inévitable exception de la nécessité militaire constitue un risque de contournement de la protection des biens culturels. Le problème réside dans l'ambiguïté de ce qui constitue un soutien à l'effort militaire qui ne figure pas non plus dans les Protocoles additionnels ni dans la Convention de La Haye de 1954.
B- Les Contraintes politiques
La Convention de La Haye de 1954 et la Convention de l'UNESCO de 1972 ont constitué la première tentative formalisée de protéger les biens culturels des ravages de la guerre et de préserver les biens culturels qui relient les peuples à leur histoire. Pourtant, malgré ces efforts fondamentaux, la protection des biens culturels demeure profondément défaillante, principalement en raison de l'absence de mécanismes exécutoires, d'engagement politique et d'intégration suffisantes des populations et du milieu ambiant. En fait, ces Conventions constituent un cadre normatif plutôt que des instruments de prévention. Leur but est ambitieux mais leurs obligations sont vaguement définies et leurs outils de responsabilisation largement symboliques. Par conséquent, ces Conventions n'ont pas réussi à dissuader la destruction des biens culturels dans beaucoup de pays. A titre d’exemple, ces Conventions n’ont pas réussi à empêcher la destruction du musée de Bagdad, des Bouddhas de Bamiyan et de Palmyre en l'absence de conséquences même si les efforts de l'UNESCO en matière d'éducation, de diplomatie et de reconstruction sont louables, ils ne constituent pas des substituts suffisants à l'application et à la protection sur le terrain.
En réalité, les facteurs politiques et surtout idéologiques compliquent encore davantage la protection des biens culturels. En effet, le patrimoine n'est pas neutre car incarner la résistance, la pluralité ou des histoires qui gênent les détenteurs du pouvoir. Ainsi, le ciblage des sites culturels, que ce soit par des armées d'occupation ou des groupes extrémistes, constitue une stratégie délibérée de domination de l'identité et de la mémoire. Or, les Conventions ne parviennent pas à anticiper ni à répondre adéquatement à la politisation du patrimoine, en particulier entre les mains d'acteurs non étatiques et de régimes autoritaires. Lorsque la destruction culturelle est utilisée comme une arme de guerre idéologique et psychologique, les protections prévues par les Conventions internationales sont symboliques et insuffisantes.
Néanmoins, ces Conventions ont réussi à construire une conscience mondiale du patrimoine culturel en tant qu'héritage humain commun. Ils ont contribué à créer des plateformes de dialogue international, des programmes de formation pour le personnel militaire et des bases de données sur les biens culturels. Ces avancées, bien qu'indirectes, ont jeté les bases de systèmes de protection des biens culturels plus robustes, capables de faire face aux défis actuels. On peut citer à titre d’exemple en 2003, la dévastation du patrimoine culturel, ou destruction du patrimoine de Mossoul par l'État islamique (EI) ont révélé les lacunes de la Convention de 1954 dans les zones de conflit.
C- Les faibles mécanismes de sanctions
Les deux traités dépendent du respect des États, avec une responsabilité minimale. Le Deuxième Protocole de la Convention de 1954 prévoit la responsabilité pénale individuelle mais il est rarement utilisé. De plus, la Convention de 1972 ne prévoit aucun mécanisme de sanction.
Pour renforcer la Convention de La Haye de 1954 et la Convention de l'UNESCO de 1972, plusieurs réformes juridiques et institutionnelles sont nécessaires. Premièrement, il est nécessaire de mettre en place un système de sanctions contraignantes, ou un mécanisme de saisine des cas de destruction de biens culturels par les tribunaux internationaux. Le respect des traités doit être renforcé par la création d'institutions autonomes capables de surveiller le respect par les États des exigences des traités de protection des biens culturels.
D- Souveraineté et Intervention
La souveraineté des États constitue un défi majeur pour la mise en œuvre de la protection du patrimoine21. Elle interdit toute ingérence internationale, sauf autorisation expresse de l'État, ce qui rend les sites culturels vulnérables. Cette situation empêche toute surveillance et retarde les actions juridiques ou réparatrices, aggravée par le faible taux de ratification du Deuxième Protocole de 1999.
E- Faiblesse de la gouvernance et acteurs non étatiques
Les États fragiles manquent de capacités pour protéger leur patrimoine, ce qui permet aux acteurs non étatiques ou aux trafiquants de l'exploiter. En Irak, Daech a pillé des biens culturels à Mossoul et Nimroud et les a vendus au marché noir pour financer ses opérations. Bien que la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies ait criminalisé ce commerce, l'application des sanctions reste minimale.
F. Le dilemme de la responsabilité de protéger : le patrimoine culturel doit-il être protégé comme les civils ?
La doctrine de la responsabilité de protéger (R2P) autorise une action internationale pour mettre fin aux atrocités commises contre les populations civiles mais n'inclut pas le patrimoine culturel. Cette omission exclut la destruction du patrimoine du champ d'action d'une réponse internationale urgente. L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 a protégé les civils, mais n'a pas réussi à empêcher le pillage du site de Cyrène. De même, les bombardements répétés de la vieille ville de Sanaa au Yémen depuis 2015 n'ont donné lieu à aucune action fondée sur la responsabilité de protéger. Malgré des pertes culturelles évidentes, le droit international offre peut de recours. Souvent, les agences internationales évitent toute intervention en raison de sensibilités liées à la souveraineté. L'exclusion de la responsabilité de protéger le patrimoine culturel laisse des sites irremplaçables sans défense.
G- Le patrimoine comme arme idéologique
Le patrimoine culturel sert souvent à la fois de symbole identitaire et d'outil de domination. Historiquement, les puissances conquérantes ont effacé ou redéfini les récits culturels antérieurs. Dans les conflits modernes, le patrimoine est utilisé pour démoraliser les communautés ou pour légitimer des idéologies politiques.
Un exemple notable est la destruction des Bouddhas de Bâmiyân par les talibans en 2001. Ces monuments du VIe siècle symbolisaient le passé multiculturel de l'Afghanistan. Leur démolition délibérée a envoyé un message politique de contrôle idéologique. Bien que l'UNESCO ait condamné cet acte, aucune intervention ni poursuite significative n'a suivi, soulignant les limites des outils juridiques internationaux contre des acteurs non-étatiques déterminés. Une éventuelle reconstruction de ces statues géantes soulève une grande controverse éthique et historique
H- Le patrimoine comme bien économique
De nos jours, le patrimoine culturel n'a pas seulement une valeur politique, il a aussi une valeur économique faisant de ce patrimoine un atout stratégique. Les objets pillés atteignent des prix élevés et servent souvent à financer des acteurs non-étatiques violents. En outre, au niveau interne, les projets de réaménagement à grande échelle reflètent souvent une tendance à l'exploitation du patrimoine à des fins lucratives en détruisant ou en déplaçant les communautés locales.
En outre, les efforts internationaux en faveur de la protection des biens culturels exigent la participation des populations locales.
I- Les difficultés d’application au niveau interne
Un autre problème majeur est l'absence d'obligations d'application et de mécanismes de suivi spécifiquement conçus pour la protection des biens culturels. D'une part, ces conventions ne sont contraignantes que pour les États parties qui les ont ratifiées et signées. D’autre part, une autre faiblesse des Conventions réside dans l'absence de protection dans les conflits armés non internationaux. Ce problème se pose principalement dans le Protocole II, qui traite des conflits internes. L'article 16 ne prévoit qu'une interdiction générale des actes d'hostilité contre les biens culturels, mais il est dépourvu de nombreuses mesures rigoureuses telles que le marquage des sites protégés par l'emblème du Bouclier bleu, des dispositions relatives à un statut de protection renforcée et des mécanismes détaillés de suivi ou d'application. Cette situation soulève un problème majeur car la plupart des conflits armés contemporains sont non internationaux et impliquent des États et des groupes armés non-étatiques au sein d'un même pays. Ce vide juridique est d'autant plus problématique qu'une grande partie des destructions du patrimoine culturel survenues ces dernières décennies ont eu lieu lors de conflits internes, où ces protections renforcées ne s'appliquent pas ou ne peuvent être efficacement mises en œuvre.
Conclusion
Malgré leur importance, les Conventions de 1954 et de 1972 ne répondent pas toujours aux menaces complexes que constituent les guerres modernes, l'extrémisme idéologique, le fanatisme religieux et l'instabilité politique. Une série de réformes doit être mise en œuvre visant à lier les obligations juridiques des états à leur application, coordonner les stratégies civiles et militaires et tirer profit des nouvelles technologies et de l'engagement de la société civile.
Les articles juridiques de la protection des biens culturels doivent être renforcés par l'introduction de mécanismes d'application et de sanctions. Ces amendements à la Convention de La Haye de 1954 devraient imposer une responsabilité renforcée des acteurs étatiques et non étatiques, et le report automatique des violations devant des instances judiciaires internationales. Le précédent de la CPI dans l'affaire d’Ahmed Al Mahdi qui a été condamné à neuf ans de prison pour avoir détruit des bâtiments religieux et historiques dans la ville de Tombouctou au Mali, devrait être élargi pour englober une catégorie plus large de crimes culturels, précisant clairement que la destruction intentionnelle de biens culturels est une infraction passible de poursuites pénales.
Parallèlement aux poursuites judiciaires, des sanctions économiques et diplomatiques devraient être codifiées dans les Conventions de protection des biens culturels. Cette protection des biens doit avoir un coût politique en cas de violation. Ces sanctions pourraient être administrées en coopération avec le Conseil de sécurité de l'ONU, Interpol et l'Organisation mondiale des douanes. En outre, les États qui ne préviennent pas à protéger ou qui participent à la destruction du patrimoine culturel devraient en subir les conséquences sous forme de restrictions financières internationales, d'embargos commerciaux, ou de suspension de leurs participation dans les organisations internationales.
Une deuxième recommandation concerne l'intégration de la protection des biens culturels dans la doctrine des opérations militaires. Cela comprend l'intégration de conseillers culturels au sein des forces armées et de maintien de la paix et l'élargissement de la reconnaissance de l'emblème du Bouclier bleu dans les zones de combat. La protection culturelle devrait être une norme dans la planification opérationnelle, et non une considération collatérale.
Une troisième recommandation concerne le renforcement des capacités de prévention. La communauté internationale devrait investir dans des systèmes de surveillance et d'alerte précoce basés sur les technologies modernes. L'imagerie satellitaire, la détection des menaces par l'IA et le signalement des dommages en temps réel pourraient permettre à des institutions comme l'UNESCO de signaler les risques et d'intervenir avant que la destruction ne survienne.
Par ailleurs, les institutions internationales doivent améliorer leur coordination avec les communautés locales et la société civile, car les biens culturels sont mieux préservés lorsque leurs proches sont habilités à les défendre. Par conséquent, les acteurs locaux devraient bénéficier d'un soutien financier, logistique et juridique pour surveiller les sites et mettre en œuvre des programmes de conservation locaux. L'UNESCO peut jouer un rôle de facilitateur en offrant des subventions et en connectant les communautés aux réseaux mondiaux d'experts. La protection du patrimoine culturel au XXIe siècle exige une stratégie intégrée adaptée à toutes les situations alors que l'importance symbolique et stratégique des biens culturels ne cesse de croître. D’autre part, les technologies modernes offrent des garanties supplémentaires comme la surveillance par satellite permettant de détecter les fouilles illégales sur des sites isolés et d'établir des archives numériques, ce qui permet de préserver le patrimoine immatériel menacé.
Enfin, il faudrait explorer la possibilité de créer une organisation internationale qui veillerait au respect du droit international relatif aux biens culturels, enquêterait sur les violations présumées des dispositions des conventions et rédigerait des rapports détaillés pouvant servir ultérieurement de preuve pour poursuivre les contrevenants.
Bibliographies
1. Chechi, A., The Settlement of International Cultural Heritage Disputes. Oxford University Press, 2014.
2. European Commission, EU Funding for Cultural Heritage in Lebanon. Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-funding-for-cultural-heritage-in-Lebanon, 2020.
3. Gerstenblith, P. , Protecting Cultural Heritage: The Ties between People and Places. In J. Paul Getty Trust (Ed.), Cultural Heritage Under Siege (pp. 26–37). Los Angeles: The Getty Conservation Institute. getty.edu papers.ssrn.com, 2016.
4. Huttunen, M., The Institutionalisation of Heritage Protection and the (de) Legitimisation of War. International Peacekeeping, 32(1), 88–112.doi:10.1080/13533312.2025.2481470 researchgate.net researcher.life, 025.
5. ICC.,Prosecutor v. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi . Case No. ICC-01/12-01/15. Retrieved from https://www.icc-cpi.int/cases/icc-01-12-01-15, 2016.
6. ICOMOS & Blue Shield, Cultural Heritage Threatened by the War in Lebanon 2006. In Heritage at Risk Report 2006/2007 (pp. 107–110). Paris: International Council on Monuments and Sites. icomos.org, 2007.
7. UNESCO, La Convention de la Haye de 1954 et la Convention du Patrimoine mondiale de l’UNSCO de 1972.
8. UNESCO, Heritage in Danger: Monitoring Conflict Zones . Paris: UNESCO Publications, 2023.
9. UNESCO, Second Protocol Ratification Status Report . Retrieved from https://whc.unesco.org/en/protocol/, 2023.
10. UNSC, Report on Libyan Artifact Trafficking (S/2022/562). Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/562/00/PDF/N2256200.pdf, 2022.
11. UNSC, Report on the Protection of Cultural Property in Armed Conflict (S/2022/562). Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/562/00/PDF/N2256200.pdf, 2022.
12. UNESCO Lebanon: 34 cultural properties placed under enhanced protection. UNESCO Press Release, 18 Nov 2024. unesco.org, 2024.
13. Francioni, F. , The Human Dimension of Cultural Heritage: From Rights to Remedies,
Oxford University Press, 2020.
14. Francioni, F. & Lenzerini, F., The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law. European Journal of International Law, 14(4), 619–651, 2003.
15. O’Keefe, R., . Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
16. Van der Auwera, Sigrid. “Contemporary Conflict, Nationalism, and the Destruction of Cultural Property.” Journal of Conflict Archaeology, vol. 7, no. 3, 2012, pp. 169–195.
Annexe
Liste de sites libanais bénéficiant d’une protection renforcée de l’UNESCO
1. Site archéologique d’Adlun
2. Site archéologique d’Afqa
3. Temple et site archéologique d’Aïn Herché
4. Site archéologique d’Anjar
5. Sites archéologiques de Baalbek
6. Palais de Beiteddine
7. Byblos
8. Citadelle de Chama.
9. Site archéologique de Dakerman
10. Château de Doubiyé-Chaqra
11. Temple de Hebbariyé
12. Temple de Hosn Niha
13. Pont romain de Jeb Jannine
14. Site archéologique de Porphyreon-Jiyé
15. Fort de Kaifoun
16. Sites archéologiques de Kharayeb
17. Temple de Majdel Anjar
18. Temple de Nahlé
19. Site archéologique de Nahr el-Kalb
20. Site archéologique d’Oum el‘Amed
21. Qalaat Al-Chakif – Château de Beaufort
22. Qalaat Deir Kifa (Château de Maron)
23. Qalaat Tibnin (Château de Toron)
24. Temple de Qasarnaba
25. Foire internationale Rachid Karameh-Tripoli
26. Bassins et patrimoine bâti de Ras Al Aïn
27. Site archéologique de Sarepta
28. Sites archéologiques de Sidon
29. Site archéologique de la source d'Aïn el Jobb (Temnine el Faouqa)
30. Site archéologique de Tell el-Burak
31. Sanctuaire d’Echmoun
32. Sites archéologiques de Tyr
33. Musée national de Beyrouth
34. Musée Nicolas Ibrahim Sursock
حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي
البروفسور جورج لبكي
تترافق العمليات العسكرية غالبًا مع إحداث دمار هائل في الممتلكات الثقافية لا يمكن تعويضها. وقد تعرّض لبنان إلى الكثير من الاعتداءات منذ أكثر من نصف قرن طاولت العديد من ثرواته الأثرية والتاريخية. قدّمت منظمة اليونسكو العديد من المساعدات للحفاظ على هذه المعالم وترميمها لأنها تشكل جزءًا قيّمًا من التراث الإنساني. وتجلّت هذه الحماية وفق البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي بإدراج ٣٤ معلمًا أثريًا على لائحة هذا التراث العالمي.
وقد عُقدت اتفاقيات لحماية الممتلكات الثقافية أبرزها: اتفاقية لاهاي في العام 1954، بروتوكولان تكميليان واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية في العام 1972؛ وتلك الثقافية تتكون من ممتلكات منقولة وثابتة ذات أهمية كبرى لتراث الشعوب. قضت هذه الاتفاقية بالتزام الدول الموقّعة عليها بحماية الممتلكات الثقافية من الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة وعدم التذرّع بالضرورات العسكرية للتمركز فيها أو مهاجمتها، ما يعرّضها للتدمير والخراب. انطلاقًا من أنّ هذه الاتفاقية توفر الحماية اللازمة للممتلكات الثقافية، لذلك توجد ضرورة لتعديلها من خلال إضافة آليات تعقب ورصد، وكذلك فرض عقوبات على الدول والأفراد الذين يقومون بالاعتداء على الممتلكات الثقافية وإشراك المجتمع المحلي بالحفاظ عليها. ومن هذه الإجراءات إنشاء محاكم دولية لمعاقبة مرتكبي الاعتداءات على المعالم الأثرية وتوسيع صلاحيات المحكمة الجزائية الدولية في هذا شأن. بالإضافة إلى ذلك يجب على المجتمع الدولي ملاحقة المهرّبين والمتاجرين بالآثار.
وأخيرًا، يجب توعية الرأي العام على أهمية التراث العالمي الإنساني ومحاربة التطرف الأيديولوجي والتعصب اللذَين يسببان الكثير من الأضرار للمعالم الأثرية في مختلف أنحاء العالم.